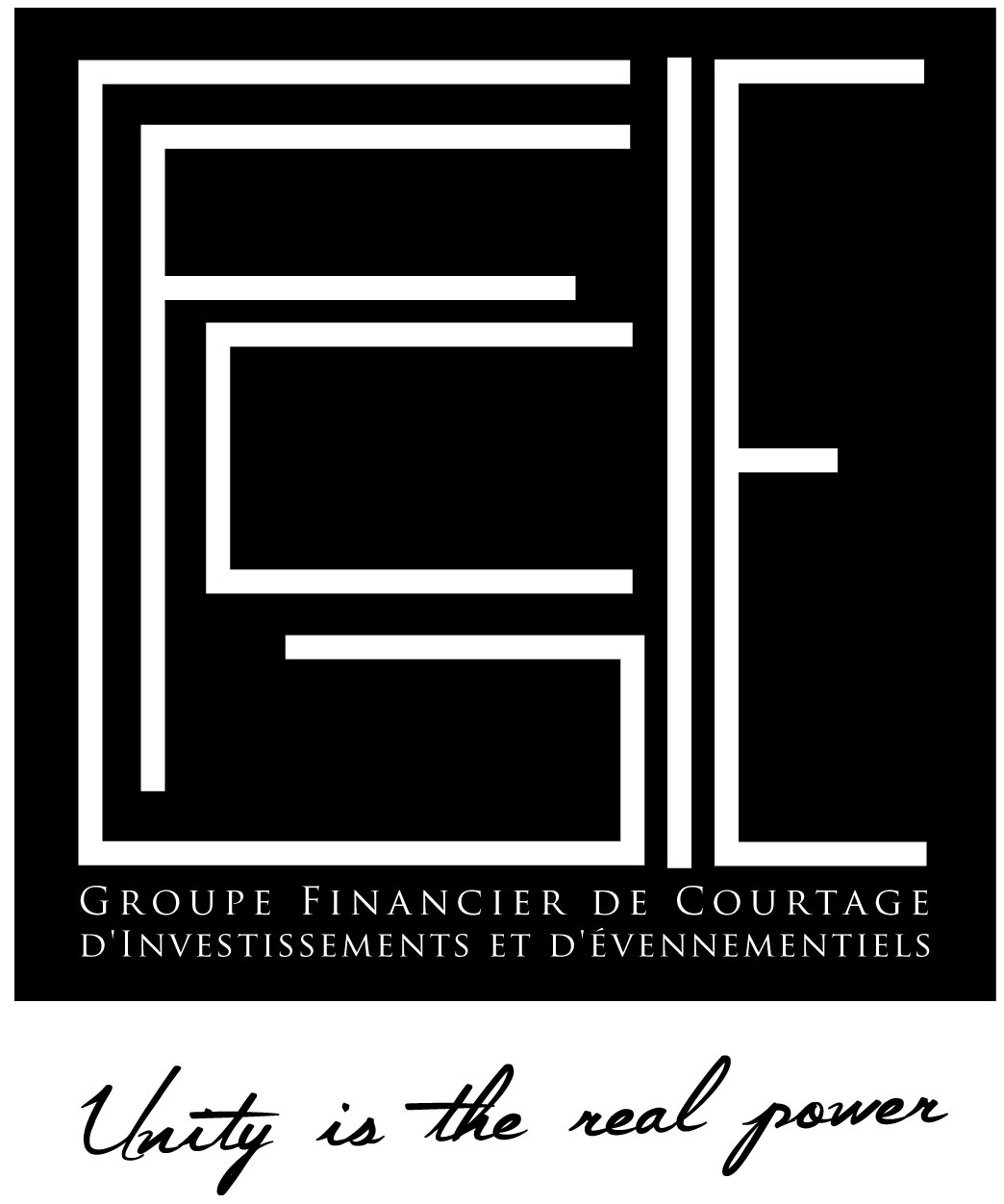Née en 1968 à Niodor au Sénégal, est une femme de lettres franco-sénégalaise. Elle est née sur la petite île de Niodior, dans le delta du Saloum, en pays sérère, au sud-ouest du Sénégal. Fille naturelle, ses parents ne sont donc pas mariés, elle est élevée par sa grand-mère, Animata. Son nom vient du Sine Saloum, où les Diome sont des Niominka. Elle tombe amoureuse d’un Français, se marie et décide de le suivre en France à Strasbourg en 1994. Elle divorcera deux ans plus tard. Après des études de lettres et de philosophie à l’université de Strasbourg, elle y donne des cours, puis enseigne à l’Université Marc-Bloch de Strasbourg et à l’Institut supérieur de pédagogie de Karlsruhe, en Allemagne. Elle reçoit les insignes de doctorat honoris causa à l’Université de Liège en 2017.
« Le ventre de l’Atlantique » aux éditions Carrière
Ce roman met en scène les rêves d’émigration des jeunes Sénégalais. Il a une dimension autobiographique, les lieux (Niodior, Strasbourg) et la vie de la narratrice coïncidant avec ce que l’on sait de la vie de l’auteur. Fatou fille met en exergue l’intérêt des jeunes africains à considérer la France comme un paradis.
À Strasbourg, la narratrice doit renseigner au téléphone son demi-frère Madické du déroulement des matchs de football de l’équipe nationale d’Italie qu’il ne peut pas suivre à la télévision sur l’île de Niodor, au large du Sénégal. Comme les garçons de son âge, il projette de venir lui aussi en France pour devenir un célèbre et riche footballeur, s’identifiant à quelques brillants Sénégalais jouant dans les clubs français. Le livre est un incessant aller-retour entre le Sénégal et la France, où la narratrice décrit sans concession la situation faite aux immigrants vite devenus clandestins, face au racisme et aux menaces d’expulsion. Mais elle est lucide aussi avec son village d’origine, où l’analphabétisme, la situation des femmes, le pouvoir des marabouts, la tendance à tout exiger de ceux qui se sont expatriés, sont évoqués sans fard. De même
qu’est soulignée l’inégalité foncière entre le Français qui peut sans visa faire du tourisme (même sexuel) au Sénégal, et le Sénégalais pour lequel l’obtention d’un visa pour la France est un parcours semé d’obstacles, y compris financiers.